#1 le traduisible
TRADUCTIONTHÉÂTREDRAMATURGIE
Erica Letailleur
7/30/2024
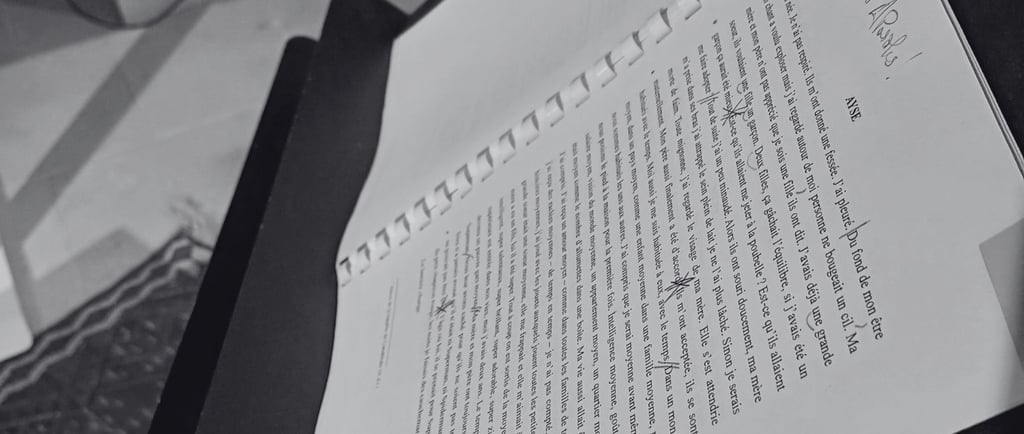
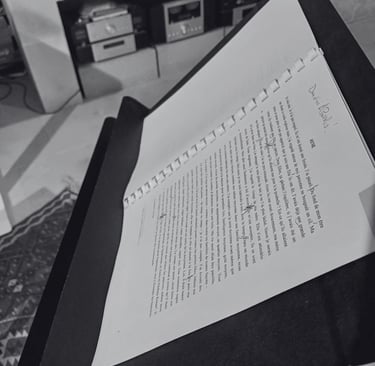
#1 Le traduisible
Depuis quelques années, après avoir voyagé beaucoup, j’ai choisi de poser mes valises. Lorsque je les ai ouvertes, j’ai vu que celles-ci étaient pleines d’expériences, de saveurs, de parfums, de sons venus d’un autre univers culturel auquel j’avais fini par me familiariser. Pourtant, lorsque je cherchais à les raconter, ceux à qui j’en parlais ici ne saisissaient pas toujours ou pas totalement. C’était parfois une histoire de mots : un mot existe dans une langue mais pas dans l’autre, par exemple.
C’est peut-être à ce moment-là, que j’ai compris qu’il était important de rendre compte de ce décalage. Est-ce que c’était un simple constat d’altérité, de différence paradigmatique, d’incommunicabilité… ? Ce changement de perspective (ou plutôt ce glissement culturel) s’est combiné au travail que j’avais fourni année après année, pas à pas, pour assimiler de nouveaux codes jusqu’à ce que ceux-ci deviennent aussi un peu les miens aujourd’hui. Finalement, ma propre identité s’est refondue à travers l’assimilation d’une langue nouvelle, qui inclut une vision de la vie totalement différente et par conséquent, une multiplication des mondes intérieurs.
J’ai alors décidé de commencer à partager, à travers l’expérience de la traduction théâtrale et de l’écriture d’articles de recherche, certains aspects de ce prisme. Et pour cela, j’ai commencé par faire lire les textes que j’avais déjà traduits (et ceux que je souhaitais traduire) et qui m’intéressaient.
Parmi eux, il y avait des pièces d’auteurs très reconnus comme Güngör Dilmen ou encore Melih Cevdet Anday, par exemple. Il y avait aussi des ouvrages théoriques et historiques de Metin And ou de Sevda Şener, notamment. Il y avait encore des pièces plus contemporaines, comme celles de Zeynep Kaçar, par exemple. Je dois d’ailleurs dire que c’est elle qui m’a conduite, à travers des hasards des rencontres et de la vie, à poursuivre et amplifier cette démarche de traduction entamée alors.
Il faut, pour comprendre, remonter quelques années en arrière. En 2019, j’étais prof au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique d’Ankara (Université de Hacettepe), et j’ai traduit une pièce que l’une de mes élèves m’avait apportées pour son projet de diplomation. Il s’agissait de Krem Karamel (Crème Caramel), de Zeynep Kaçar. Une farce délirante, un pas-tout-à-fait monologue, qui met en scène une présentatrice d’émission de cuisine prise au piège de son propre show. Une critique acide et vibrante de la condition de la femme au foyer coincée devant (derrière) son écran, obligée de faire confiance à un prince charmant-superman incapable. C’est aussi un procès cinglant de la société de surconsommation qui grignote minute après minute notre temps de cerveau disponible… J’étais heureuse d’avoir traduit cette pièce et j’ai demandé l’autorisation à Zeynep de la proposer à une maison d’édition française. Très rapidement, elle m’a répondu qu’elle était ravie que son œuvre puisse être traduite en français, mais qu’elle ne souhaitait pas particulièrement que ce soit cette pièce-là, qu’elle trouvait encore verte. Elle m’a dit qu’elle en préférait une autre, qu’elle m’envoyait en même temps. C’était Les Aventures merveilleuses de l’inexistante Ayşe. Une non-histoire, qui présentait une non-héroïne racontant sa non-existence, parce qu’elle était passée à côté de sa vie, à force de répondre à toutes les injonctions familiales, sociales et culturelles. Tous simplement parce qu’elle était une femme. J’ai commencé à traduire cette pièce et puis il y a eu les confinements successifs, la remise en question de l’essentialité de nos professions et des arts vivants… j’ai capitulé pendant un temps, enfermant le manuscrit inachevé au fond d’un tiroir, et prenant le temps pendant quelques années, de repenser les arts vivants et le théâtre, pour moi-même.
Puis j’ai quitté Paris et quelques mois plus tard, je recevais un message de Zeynep Kaçar, qui me demandait si j’avais pu terminer la traduction d’Ayşe, car elle souhaitait pouvoir dire à son éditeur français (qui projetait alors de publier son dernier roman) si elle avait d’autres œuvres déjà traduites dans notre langue. Évidemment, j’ai repris le dossier dans la foulée, et terminé la traduction dont il ne restait que quelques pages, avant de lui envoyer le tout. Et pendant ce temps de retravail, j’ai pris conscience de l’intérêt, de la subtilité et de la beauté de cette pièce – que je n’avais peut-être pas suffisamment remarquée, lors du premier jet. A petit à petit germé l’idée de mettre en valeur ce travail. La première des démarches que j’ai effectuée, a été de prendre contact avec la Maison Antoine Vitez et de demander s’il était possible d’inscrire cette œuvre à son répertoire. En principe, le parcours est le suivant : le traducteur et l’auteur soumettent un dossier de demande d’aide à la traduction, et s’il est retenu par le comité, alors une bourse est attribuée et la pièce une fois traduite est ajoutée au répertoire. Pourtant, comme il y a très peu d’œuvres turques au répertoire de la Maison Antoine Vitez, les membre du comité ont accepté d’ajouter cette pièce hors concours, hors bourse. De fil en aiguille, j’ai décidé de continuer à valoriser le travail commencé, en mettant la pièce en lecture, puis en en proposant une mise en scène qui a pu voir le jour grâce à la confiance et la générosité de Dominique Czapski, directeur artistique du Théâtre Antibéa, à Antibes. C’est ce parcours qui a impulsé la création de La Réenchanterie – mais c’est une autre histoire.
Si l’on revient à la question de la traduction, après cette pièce, deux événements se sont produits. Le premier, c’est que la Maison Antoine Vitez m’a proposé de prendre en main le Comité de Langue Turque, ce que j’ai accepté avec joie. Le second, c’est que j’ai repris mon exploration du répertoire turc contemporain avec une curiosité renouvelée, et j’ai commencé à proposer des textes à la traduction du turc au français. Parallèlement, sur demande de certains artistes des Théâtres Nationaux de Turquie, j’ai également commencé à faire le chemin inverse : du français au turc, j’ai réexploré le répertoire contemporain français et commencé à proposer des œuvres à la traduction.
Étrangement, des deux côtés des frontières, la même attente était formulée : on me demandait des pièces politiques, des pièces engagées, des pièces qui parlent aux professionnels comme aux publics auxquels ils s’adressent.
C’est évidemment un sujet délicat, au vu de la situation complexe des relations politiques et diplomatiques entre les deux pays. J’ai donc commencé par me demander si, en faisant œuvre de traduction, il était absolument indispensable de porter la bannière de tel ou tel message politique, surtout lorsque celles-ci étaient partisanes. Bien sûr, traduire, c’est un acte politique. Reste à savoir à quel degré politique on se situe et pour dire quoi. Pour susciter l’intérêt de quels professionnels et de quels publics et quelles sont les conséquences dramaturgiques, esthétiques, linguistiques, personnelles, diplomatiques directes de tels choix.
Traduire, c’est à la fois rendre compte et orienter. C’est faire le choix de montrer l’altérité selon une partie du prisme, qui n’est nécessairement pas une vue d’ensemble. Je pense à Vitez et à sa formule devenue célèbre : « Traduire, c’est déjà mettre en scène ». Traduire, c’est donner à voir un univers artistique, littéraire et linguistique singulier, à travers son propre regard. Finalement, c’est, comme souvent, une question de point de vue.
Avec toutes ces réflexions et toutes ces questions, j’ai fouillé plusieurs semaines, plusieurs mois dans les répertoires français d’un côté, turc de l’autre. J’ai échangé avec différents professionnels, chercheurs, arbitres des élégances en France et en Turquie, et arrêté mes premiers choix de traduction. Du côté turc, pas encore de réponse mais il semblerait que choisir de parler du rapport au travail dans notre société soit une bonne porte d’entrée. Du côté français, j’avais pris le parti de continuer à explorer le théâtre féministe, porteur d’un discours qui dépasse les frontières. J’ai trouvé une pièce intéressante (bien que présentant quelques faiblesses dramaturgiques, à certains passages) que j’ai soumise au Comité de lecture de la Maison Antoine Vitez. Mais la pièce a été refusée car elle ne semblait pas répondre à certaines caractéristiques esthétiques et dramaturgiques attendues par les professionnels et les publics français : ce refus a été une excellente occasion de me questionner plus profondément sur les enjeux de la traduction théâtrale.
Qu’est-ce qui est traduisible et sur quels critères ? Une pièce mérite-t-elle d’être traduite parce qu’elle répond à un certain nombre d’éléments attendus par les futurs lecteurs dans la langue et la culture cible, ou justement, parce qu’elle évoque dans sa forme et son contenu, une perception du monde qui n’est pas la même que la nôtre? En somme, pour qui est-ce qu’on traduit quoi ?
Je n’ai pas de réponses vraiment tranchées.
D’un côté, il me semble qu’il est important de proposer des œuvres dans lesquelles les futurs spectateurs et artistes pourront se reconnaître, afin qu’ils puissent se les approprier. Pour autant, cela ne peut (et ne doit) pas se faire au risque d’omettre des pans de culture (des esthétiques, des discours) déroutants, parce qu’ils incarnent la promesse d’un dépaysement littéral, dans lequel les repères culturels, esthétiques et linguistiques, sont chamboulés. C’est une question de déplacement et d’acceptation. C’est une question profondément ethnographique, au cœur de la démarche vers l’ailleurs, où l’on finit par se reconnaître soi-même en se regardant en miroir dans la pupille de l’œil de l’autre.
Une démarche dans laquelle les attentes et les présupposés sont laissés devant la porte.
